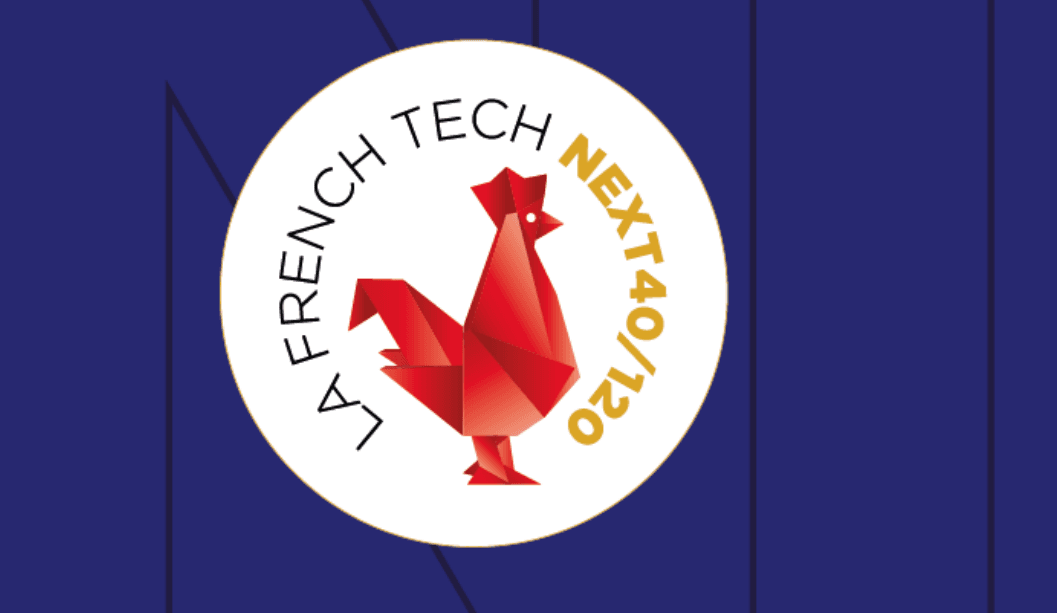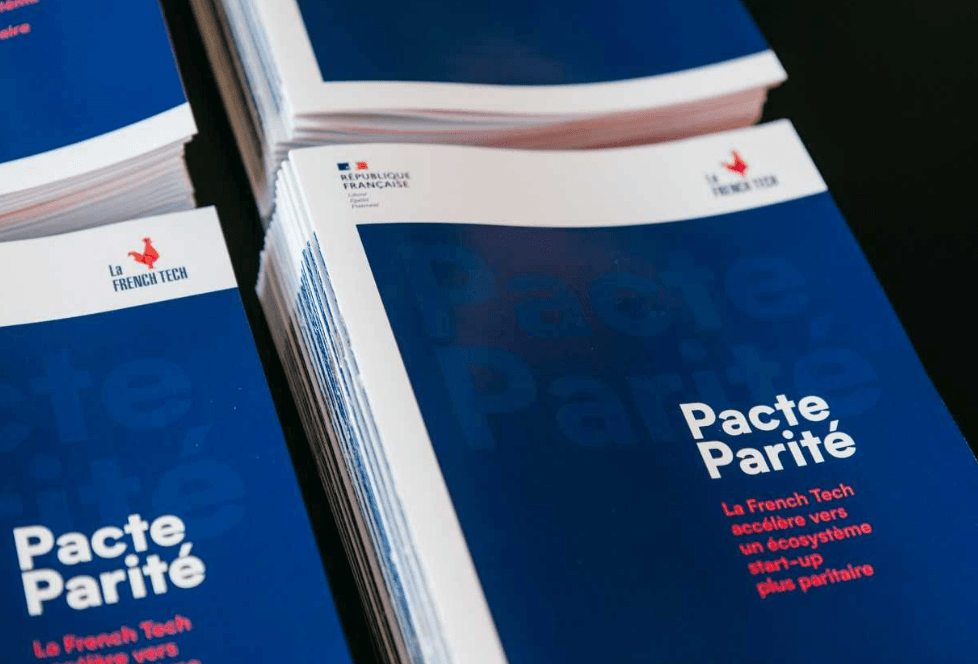Dans cette interview exclusive, Maxime Blondel, fondateur de The Quest, revient sur une aventure qui bouscule les codes de l'entrepreneuriat en France. À mi-chemin entre l’incubateur et le startup studio, The Quest mise sur les jeunes talents de 17 à 27 ans prêts à tout pour transformer leurs idées en entreprises ambitieuses.
L’histoire des Zuckerberg, Gates ou Jobs repose sur un déclic audacieux – celui de quitter les bancs de l’école pour suivre leur instinct. À 20 ans, Maxime Blondel fait le même pari et se lance dans l'entrepreneuriat. En 2020, il fonde The Quest avec une ambition claire : offrir ce même élan aux jeunes Français de 17 à 27 ans. Chez lui, pas de discours lisses ni de chemins balisés : les drop-outs sont à l’honneur. Ce terme, souvent perçu négativement, désigne ceux qui osent interrompre leurs études pour suivre leur ambition. Pour Maxime Blondel, ce choix cristallise une maturité précoce et une force de caractère essentielle à tout entrepreneur.
Concrètement, The Quest sélectionne chaque année une dizaine de projets prometteurs. À la clé : un financement de 100 000 euros, un accompagnement opérationnel intensif et une immersion dans l’univers exigeant des start-ups. The Quest ne se contente pas de soutenir les idées : le programme propulse ses poulains, les guide dans la structuration de leur équipe, la création de leur produit et l’acquisition de leurs premiers clients. Inspiré par des modèles comme la Thiel Fellowship aux États-Unis, Maxime Blondel rêve grand : faire émerger depuis la France les futurs géants de la tech mondiale.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesMaxime Blondel, pourriez-vous vous présenter ?
J’ai 29 ans et j'ai arrêté mes études à 20 ans pour lancer une première startup. Enfin, ce que je pensais être une startup car on a fait absolument tout ce qu’il ne fallait pas faire ! Il s’agissait d’une application pour aider les jeunes à trouver du travail. À l’époque, LinkedIn n’était qu’une simple banque de CV, sans les fonctionnalités sociales qu’on lui connaît aujourd’hui. L’idée était de créer un "meilleur LinkedIn" spécifiquement pour les étudiants et jeunes diplômés. Une intuition intéressante, mais mal exécutée.
Quelles erreurs ont marqué cet échec ?
Il y en a eu plusieurs. D’abord, nous étions quatre cofondateurs, mais deux seulement travaillaient à plein temps tandis que les autres poursuivaient leurs études. Cela a créé des désalignements d’intensité. Ensuite, il nous manquait un profil technique dans l’équipe, ce qui est essentiel pour construire un bon produit. Enfin, nous n’étions pas assez concentrés sur nos clients. On préférait participer à des concours de startups pour remporter 10 000 ou 20 000 euros. C’était une stratégie illusoire qui s’épuise très vite. Au bout de 11 mois, j’ai décidé de mettre fin au projet.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesVous avez enchaîné sur un autre projet. Dans quel secteur cette fois-ci ?
Pour gagner mon argent de poche, je travaillais comme barman pour une agence événementielle qui m’envoyait chaque week-end dans des clubs, pavillons, péniches… J’ai fini par accumuler une véritable base de données de prestataires dans mon téléphone : troupes de danse, DJ, photographes, food trucks, etc. Et je me suis rendu compte que mes amis ou leurs proches me sollicitaient souvent pour ces contacts. C’est là que j’ai eu l’idée de créer des sites spécialisés pour monétiser cette mise en relation.
Quel modèle avez-vous développé ?
J’ai monté une galaxie SEO composée de quatre sites ultra-spécialisés : un pour les animations, un pour les traiteurs, un pour les lieux privatifs, et un dernier exclusivement dédié aux foodtrucks. Le choix de la verticalité était essentiel. Ça paraît contre-intuitif de ne pas tout réunir ensemble, mais les clients préfèrent des plateformes spécialisées plutôt que des généralistes, qui manquent de crédibilité à leurs yeux. En deux ans et demi, ces sites sont devenus des leaders sur le marché français. À ce moment-là, j’avais 23 ans et je gérais tout seul. Puis, j’ai reçu une offre de rachat. Après l’échec de ma première start-up, c’était mon premier succès entrepreneurial.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesVous avez ensuite rejoint The Family, un incubateur très en vue à l’époque. Pourquoi ce choix ?
The Family m’a repéré à ce moment-là et m’a proposé un job salarié. Je n’avais pas besoin d’argent, mais je voyais en eux une ambition qui dépassait la mienne. C’était une opportunité d’apprentissage incroyable.
J’y ai passé un an et demi. Mais une frustration a fini par émerger : The Family accompagnait chaque année une centaine de start-ups, mais l’approche restait trop en surface. Je ressentais le besoin de m’impliquer davantage, de mettre les mains dans le cambouis et de suivre les entrepreneurs sur du plus long terme.
Cette expérience a-t-elle inspiré la suite de votre parcours ?
Oui, absolument. En décembre 2019, j’ai décidé de lancer un modèle inspiré de The Family, mais à une échelle plus réduite : The Secret Company. Mon idée était de me concentrer sur les entrepreneurs en bootstrapping, ceux qui s’autofinancent, car je trouvais qu’ils étaient les plus solides. Contrairement à d’autres, ils parlent clients et chiffre d’affaires plutôt que levées de fonds et valorisations fantasmées.
Je voulais créer une "cour de récréation entrepreneuriale" où je pourrais accompagner plusieurs projets par an : trouver le bon fondateur pour chaque idée, l’aider à constituer son équipe, lancer le produit et décrocher les 100 premiers clients. Je ne savais pas encore que ce modèle avait un nom : c’était un startup studio. Mais à l’époque, je ne connaissais même pas ce terme. Les pionniers comme eFounders, aujourd’hui Hexa, ont vraiment évangélisé ce modèle. J’ai découvert leur blog sur Medium où ils expliquaient en détail comment faire fonctionner un startup studio. Ça semblait être une galère monumentale, mais ça m’amusait. J’ai foncé.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesConcrètement, comment avez-vous démarré ?
Pendant trois ans, nous avons créé trois nouvelles startups chaque année. Je dis nous car la première année, j’étais seul, mais dès la deuxième, j’ai convaincu quatre amis de me rejoindre : Robin, Adam, Spana et Julien. Ils ne se connaissaient pas, mais avaient, à mon sens, des compétences complémentaires. Ensemble, nous avons continué à lancer des start-ups en bootstrapping.
Cette période coïncide avec l’explosion des valorisations pendant et après la pandémie. Comment l’avez-vous vécue ?
Effectivement, de 2020 à 2023, on a assisté à une envolée des valorisations. Beaucoup de start-ups levaient des fonds à des conditions folles, parfois sur un simple PowerPoint. Mais cette époque a aussi créé les fragilités qu’on observe aujourd’hui. Beaucoup de ces entreprises se retrouvent aujourd’hui en difficulté car elles ont levé des fonds trop tôt, sans véritablement chercher leurs clients. Elles n’ont pas su bâtir des bases solides.
De notre côté, sans en avoir conscience à ce moment-là, nous avons pris une autre voie. Nous avons lancé des logiciels SaaS et des applications mobiles, en nous concentrant sur la traction commerciale. À la fin de ces trois années, nos projets cumulés atteignaient 10 millions d’euros d’ARR. Ce sont des entreprises rentables aujourd’hui, qui génèrent des dividendes et qui ont des fondations solides.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesCe succès vous a-t-il fait évoluer dans votre approche ?
Oui, nous avons continué sur ce modèle malgré sa difficulté. Nous fonctionnions en saisons de 12 mois, de septembre à septembre, comme un calendrier scolaire. Lors de notre troisième saison, deux start-ups ont eu l’opportunité de lever des fonds.
Cela ne remettait-il pas en cause votre positionnement sur le bootstrapping ?
On s’est posé la question. Mais dans ces cas précis, lever des fonds était une bonne stratégie pour accélérer la croissance. Ces entreprises avaient déjà prouvé leur solidité avec des chiffres d’affaires conséquents. Finalement, l’une a levé 3 millions d’euros, l’autre 1 million. On a réalisé qu’il ne fallait pas être aussi dogmatique sur le financement.
En parallèle, nous avons pris conscience que les meilleures performances provenaient des jeunes fondateurs, souvent âgés de 17 à 27 ans. Ils partagent un ADN particulier : ils ont une relation compliquée avec l’école et, pour beaucoup, abandonnent leurs études tôt. Ça m’a frappé car cela me ressemblait. Je me suis dit : « Est-ce que je n’ai pas créé, sans m’en rendre compte, la structure que j’aurais aimé avoir à 20 ans lorsque j’ai échoué avec ma première start-up ? »
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesC’est à ce moment-là que vous vous êtes renommés The Quest ?
Exactement. Nous avons renommé notre structure The Quest et nous avons découvert aux États-Unis un modèle similaire : la Thiel Fellowship, créée par Peter Thiel. Cette organisation propose chaque année des chèques de 100 000 dollars à une vingtaine de jeunes pour leur permettre d’arrêter leurs études et de se concentrer sur un projet technologique.
Ce modèle a donné naissance à des succès majeurs comme Figma, le nouvel outil incontournable de design, ou encore Ethereum, la célèbre blockchain. Ces exemples nous ont inspirés : il fallait que nous aussi, en France, nous allions chercher les meilleurs jeunes talents.
En quoi consiste aujourd’hui The Quest ?
Nous proposons des chèques de 100 000 euros pour financer les 12 premiers mois d’un projet. Cela permet à des jeunes d’arrêter leurs études en toute sérénité ou de s’assurer un socle pour lancer leur start-up. Mais nous ne nous contentons pas de délivrer un financement : nous avons une équipe dédiée, un lieu physique et organisons des séminaires pour intensifier le rythme et soutenir ces entrepreneurs dans l’exécution de leurs idées.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesVotre modèle semble évoluer à la frontière entre le startup studio traditionnel et un incubateur. Comment décririez-vous cette singularité ?
Techniquement, on reste un startup studio parce qu’on déploie du capital pour soutenir les projets. Mais ce qui nous différencie, c’est que nous faisons moitié-moitié : la moitié des start-ups que nous lançons sont nos propres idées, pour lesquelles nous trouvons les fondateurs, et l’autre moitié provient directement des jeunes, qui arrivent avec une conviction forte et un projet en tête. Ce modèle hybride nous amuse et fonctionne bien, car il nous permet de rester ouverts tout en conservant notre expertise.
Vous ciblez spécifiquement les jeunes de 17 à 27 ans. Pourquoi cette tranche d’âge ?
Ce sont des profils qui n’ont pas encore été matrixés par le monde professionnel. Ils ne sont pas enfermés dans des schémas rigides liés aux hiérarchies, à la politique interne ou à des biais inconscients. Ils partent d’une feuille blanche, et pour nous, c’est un atout : on peut directement construire avec eux, sans avoir à déconstruire des croyances préexistantes. On aime bien se comparer à des kinés : on les manipule pour leur bien, en douceur mais avec intensité.
Ensuite, il y a des facteurs plus pratiques. En général, ces jeunes n’ont pas encore d’obligations familiales ou financières lourdes, ce qui leur permet de prendre des risques. Enfin, ils ont déjà un pied dans le futur. Ils comprennent les codes, les usages et les évolutions de société qui échappent parfois aux générations plus âgées. Leur capacité à s’approprier les nouvelles technologies ou des plateformes comme TikTok est instinctive, ce qui leur donne un avantage.
La Gen Z a une approche très différente du travail. La notion de carrière traditionnelle a disparu pour eux. Ils ont grandi dans un monde où être freelance est presque la norme, et où le succès peut être fulgurant. Vous lancez un compte TikTok, il cartonne, et le lendemain, vous avez 100 clients. Ce qui paraissait inimaginable pour des générations précédentes est devenu leur réalité.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesQuelle est votre vision sur le long terme ?
On voit notre modèle comme un jeu à 10-15 ans, un peu comme un fonds d’investissement. Notre conviction, c’est qu’en accompagnant cette génération, nous pourrons faire émerger un ou plusieurs Mark Zuckerberg français. L’histoire des Zuckerberg, Bill Gates ou Steve Jobs, est toujours la même : des jeunes brillants qui ne s’épanouissent pas dans leurs études, qui drop-out et qui se consacrent entièrement à leur rêve. C’est ce qu’on leur propose aujourd’hui.
Votre programme inclut également une immersion à San Francisco. Quel est l’objectif ?
Oui, c’est une étape clé. Une fois que nous estimons qu’un projet a atteint un certain niveau de maturité, nous finançons un mois à San Francisco pour les fondateurs. L’objectif est simple : les envoyer respirer l’air de la Silicon Valley, absorber un autre niveau d’ambition et d’état d’esprit. C’est une sorte de choc culturel positif. Certains reviennent avec des étoiles dans les yeux et une ambition décuplée. D’autres, plus humblement, réalisent l’ampleur du défi. Dans les deux cas, c’est formateur. Ils repartent soit avec des ailes, soit avec une bonne dose d’humilité.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesNe pas avoir fait d’études est un critère de pré-requis obligatoire pour rejoindre The Quest ?
Non, nous ne sommes pas aussi fermés : nous acceptons les profils qui ont fait des études, mais nous avons une préférence pour les drop-outs. Pourquoi ? Parce que cela cristallise souvent une force de caractère remarquable. Décider d’arrêter ses études, c’est un choix difficile. Cela signifie que vous avez été capable de vous affirmer face à vos proches, face à des attentes sociales, et de prendre votre avenir en main. Ce genre de maturité précoce est une qualité rare, et nous parions dessus. À 18 ans, ils ont souvent des réflexions, des attitudes et une compréhension des codes dignes d’un entrepreneur de 30 ans. Vous les placez dans une soirée de networking avec des investisseurs, et ils savent naturellement se positionner. Ils n’ont pas peur de s’adapter ou de se confronter aux autres.
Il y a aussi une part de génétique, je pense. Certains ont naturellement une psychologie plus développée, un esprit plus affûté que leurs pairs. Cela leur donne ce petit culot qui fait la différence. À cet âge-là, ils n’ont pas encore toutes les barrières mentales qui bloquent parfois les générations plus âgées.
Quels sont vos critères d’analyse pour sélectionner les candidatures ? Est-ce que vous imposez des tests ou une évaluation formelle ?
Non, il n’y a rien de formalisé à ce stade. La sélection est purement à l’œil. Avec le temps, on a développé une capacité à repérer les profils prometteurs, ce que j’appelle les bons poulains.
Le premier critère, c’est la flamme entrepreneuriale. Quand quelqu’un a cette fougue, cette envie de créer, on le sent immédiatement. À l’inverse, un candidat qui n’a pas cette flamme, ça se voit aussi. La différence est dans l’énergie : un bon profil va être animé d’une conviction, d’un rêve à défendre. Souvent, il y a un problème qu’ils détestent ou un ennemi qu’ils veulent attaquer. Cette flamme est non négociable.
Le deuxième critère, c’est la conviction forte. Il faut que la personne arrive en nous disant : « Les dix prochaines années de ma vie, je vais m’attaquer à ce problème précis ». Par exemple, l’un d’eux nous a expliqué qu’il trouvait les relations de couple appauvries par les réseaux sociaux. Il voulait développer une application dédiée au quality time pour les couples, avec des questions, des défis quotidiens pour renforcer les liens. Je ne sais pas si c’est l’avenir, mais il avait envie de défendre ce projet. C’est ce genre de détermination qu’on cherche. Une fois la flamme et la conviction identifiées, on peut tout construire autour.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesComment se déroule l’accompagnement pendant ces 12 mois ?
Notre objectif est simple : leur faire gagner cinq ans d’expérience en un an. Peu importe leur maturité, il y a des erreurs typiques de débutants qu’ils risquent de commettre : choisir le mauvais cofondateur, mal structurer leurs premiers partenariats ou encore ne pas comprendre les cycles de vente.
Nous les éduquons sur ces aspects en les mettant directement sur le terrain. La première fois, nous faisons tout avec eux. Par exemple, s’ils cherchent un cofondateur, nous rencontrons la personne et validons ou non leur choix en expliquant pourquoi. Nous intervenons sur le recrutement, le prototypage, la structuration d’équipe, et surtout la compréhension des premiers clients et du cycle de vente.
Vous êtes donc très présents au quotidien. C’est une forme de mentorat intensif ?
Oui, tout à fait. On aime se comparer aux centres de formation de football. Prenez Kylian Mbappé à ses débuts : il est sur le terrain tous les jours, entouré d’un coach pour les gardiens, un autre pour les attaquants, etc. Nous, c’est pareil. Nous sommes là pour ajuster chaque geste, chaque prise de décision. Notre rôle est de les guider pour qu’ils avancent rapidement tout en évitant les erreurs létales qui auraient pu tuer leur projet.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesComment financez-vous ces chèques de 100 000 euros ?
Nous avons créé un fonds d’investissement dédié, qui s’appelle The Quest Hippodrome – pour filer la métaphore des poulains. Il s’agit d’un fonds classique dans lequel nous levons des capitaux auprès de business angels convaincus par notre thèse des 17-27 ans drop-outs.
En échange de ce chèque de pré-seed, nous prenons une participation dans leur capital. Nous investissons 100 000 euros via une augmentation de capital, sur une valorisation de 1,5 million d’euros. Cela représente 6,76 % du capital.
Quels sont les principaux obstacles qui mènent les start-ups à l’échec ?
Dans 95 % des cas, les startups échouent pour deux raisons. La première, c’est qu’elles ne trouvent pas de product-market fit. Créer un produit que les clients veulent acheter est incroyablement difficile. Certaines équipes pivotent plusieurs fois, explorent différentes pistes, mais au bout de 18 mois, si le marché ne répond pas, il vaut mieux arrêter.
La deuxième raison, ce sont les conflits entre cofondateurs. C’est comme dans un couple : au début, tout semble parfait, mais des désaccords surgissent. Cela peut devenir ingérable et tuer l’entreprise, même si le produit est bon.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesQuelles sont vos recommandations pour éviter ces écueils ?
Le choix des associés est essentiel. Je recommande aux entrepreneurs de poser très tôt des questions difficiles : « Où te vois-tu dans cinq ans ? Pourquoi fais-tu cette boîte ? Quel est ton niveau d’ambition ? » Il faut savoir si vos valeurs et vos attentes sont compatibles. C’est comme un premier rendez-vous amoureux : si l’un veut des enfants dans trois ans et l’autre dans dix ans, il vaut mieux le savoir tout de suite.
En termes de succès, quelles sont les startups les plus performantes que vous avez accompagnées ?
Il y en a plusieurs. Une de nos réussites marquantes est un logiciel lancé il y a trois ans, minea.com. C’est un outil destiné aux commerçants pour les aider à prendre de meilleures décisions marketing. Aujourd’hui, la société réalise 6 millions d’euros d’ARR, en autofinancement. C’est une entreprise solide qui roule parfaitement bien.
Cette année, nous avons aussi lancé deux nouvelles boîtes prometteuses. La première est une application mobile pour les couples, Cray Cray. Présente dans neuf pays, elle fonctionne très bien, notamment grâce à son succès organique sur TikTok. Chaque semaine, on cumule 15 millions de vues sur la plateforme. C’est une app qui apporte du quality time aux couples, avec des questions profondes et des défis pour renforcer les liens.
La deuxième start-up, c’est Spectra, un projet beaucoup plus deep tech. À l’origine, il y a une étudiante en 8ᵉ année de médecine qui a décidé d’arrêter ses études pour se concentrer sur une technologie peu explorée : la spectroscopie Raman. C’est une méthode d’analyse de la matière par la lumière, utilisée en industrie. Elle pense que cette technologie peut révolutionner l’analyse de sang.
On l’a aidée à trouver un CTO polytechnicien, spécialiste en spectroscopie Raman et en quantum computing. Aujourd’hui, c’est l’une des startups les plus ambitieuses du portefeuille. Bien sûr, les projets deep tech demandent plus de temps et de financements, mais leur potentiel est immense.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesVous semblez jongler entre des projets très différents. Comment maintenez-vous un équilibre entre créativité et rentabilité ?
C’est un équilibre subtil. On divise nos projets en deux catégories :
- 50 % de paris rationnels, où l’objectif est d’obtenir rapidement une preuve de marché. Pour ces projets-là, on sait au bout de 30 jours si les clients répondent présents et si l’entreprise peut s’autofinancer.
- 50 % de paris ambitieux, comme Spectra. Ces projets demandent du temps, mais s’ils réussissent, ils peuvent devenir des sociétés multimillionnaires et changer des paradigmes à l’échelle mondiale.
Quelle est votre méthode pour obtenir des résultats rapidement sur les projets plus rationnels ?
Il n’y a pas de magie, on va très vite. On ne perd pas de temps avec des artifices comme les MVP, les decks ou autres buzzwords de la Startup Nation. On revient à des fondamentaux simples :
- Qui est le client potentiel ?
- Quel est son problème ?
- Quelle solution minimale peut-on lui apporter pour laquelle il est prêt à payer ?
Avec les outils d’aujourd’hui, notamment TikTok et LinkedIn, il est possible de tester des idées en continu. Par exemple, sur TikTok, vous pouvez publier deux ou trois vidéos par jour pour voir si une idée résonne auprès de votre audience. Les boucles de validation sont rapides et permettent de savoir très tôt si un projet a du potentiel.
Obtenez les documents officiels de DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT en 2 minutes
KBIS, bilans, diagnostics... Plus de 500 000 documents téléchargés par nos clients chaque mois.
Voir les documents disponiblesQuels sont vos objectifs pour les prochaines années ?
L’objectif est de confirmer l’essai. Cela fait un an et demi que nous appliquons ce modèle avec des chèques de 100 000 euros, et nous sommes très satisfaits des résultats. D’ailleurs, des investisseurs comme Xavier Niel, via son fonds Kima Ventures, nous soutiennent. À chaque fois que nous investissons 50 000 euros, Kima Ventures co-investit automatiquement 50 000 euros supplémentaires. Cela nous donne les moyens d’accélérer.
Sur les deux à trois prochaines années, nous voulons continuer à lancer des batchs de dix start-ups par an. Notre ambition est d’identifier, dans ce lot, le prochain Doctolib, Snapchat, BeReal ou Sorare.
Et à plus long terme, si ce modèle fonctionne, l’idée serait de le franchiser. Un peu comme une école, nous pourrions imaginer des antennes dans d’autres pays pour accompagner les meilleurs jeunes talents locaux.
Enfin, quels conseils donneriez-vous à de jeunes entrepreneurs ?
Ne vous faites pas polluer par le verbiage pompeux du monde de la tech. Oubliez les MVP, les decks, et concentrez-vous sur l’essentiel : un produit, un client, et un marché. Si vous publiez une vidéo TikTok qui fait des millions de vues, c’est qu’elle intéresse les gens. C’est pareil pour un produit : si vos clients veulent payer pour l’utiliser, alors vous êtes sur la bonne voie.
Revenez à des fondamentaux simples, comme l’offre et la demande. Ne vous perdez pas dans les artifices ou les buzzwords qui compliquent tout. L’entrepreneuriat, c’est avant tout du concret : des clients, des problèmes et des solutions. Restez rationnels.